A PROPOS du livre :
Article de Jean-Paul GIRAUX
La mémoire a deux versants. Elle est ombre et soleil. Celle de Colette Klein choisit plutôt de parcourir le versant sombre du temps qui passe, de faire l’inventaire des coups reçus. Pour elle, toute mémoire est “tuméfiée“: elle est peuplée de deuils et de fantômes. Se révolter est inutile, mais “oublier que l’on vit permet, peut-être, de vivre, de croire à la beauté, et même, de s’enivrer du paysage, de s’y fondre, et de vieillir avec lui“. En fait, il y a là une certitude. Car dans ce face à face avec la mort, le poème a le dernier mot. Il est, quoi qu’on pense du paradoxe, l’antidote du silence qu’il “fortifie“. Il porte en lui des “brouillons de vie, blessures d’ombre“. Lui demander plus serait illusoire. C’est pourtant un combat qui mérite d’être tenté. Colette Klein en fait la démonstration dans cet excellent recueil, et Gérard Cléry, en conclusion de sa postface, a raison de le souligner avec cette citation éclairante de l’auteur[e] :
Rêver l’impossible et le garder en soi
derrière les yeux
à l’insu de la mort.
Jean-Paul Giraux
Poésie sur Seine n° 84
Article de Michel JOIRET (paru dans Le Non-dit)
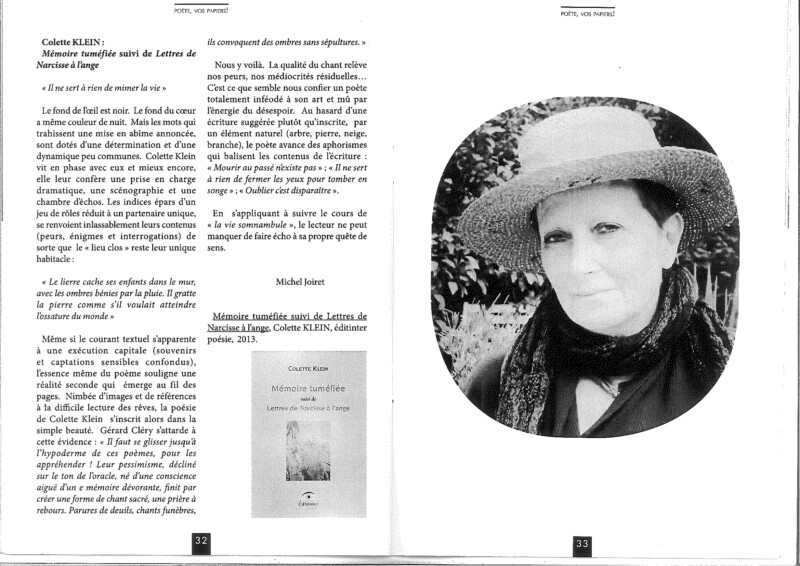
Article de Sonia ELVIREANU :
Mémoire et oubli
Colette Klein, Mémoire tuméfiée suivi de Lettres de Narcisse à l’ange
Le recueil en deux parties de Colette Klein, Mémoire tuméfiée et Lettres de Narcisse à l’ange, édité par Éditinter en 2013, avec une postface de Gérard Cléry, renvoie par son titre même aux thèmes du temps et de la mémoire, qui ne cessent de meurtrir le poète, et au mythe grec de Narcisse.
La mémoire tuméfiée par les démons acharnés du passé, ce poids qu’on trimbale toute la vie et dont on ne peut se libérer que par la poésie, fait jaillir du subconscient des images bouleversantes, avec une force déchirante :
Au fond du tableau peint sur la vitre un village, un chemin, qui mène à l’enfer : morts accrochés aux barbelés, pêle-mêle, et qui se confondent avec leur matricule, envolées de cendres vite refroidies.
Le recueil de Colette Klein, une poésie de la réflexion sur la vie/la mort, la mémoire/l’oubli se déploie en images d’une grande force de suggestion. Un seul poème en cascades, d’un dramatisme poignant, qui révèle au lecteur une conscience poétique marquée douloureusement par l’obsession de la mort. La formule d’un jeu enfantin, un, deux, trois…soleil, sert au poète à rendre sensible l’idée : un enfant joue, le visage contre le mur, se retourne brusquement et se retrouve brutalement face au vide, à l’autre bout du temps. La vie est un jeu avec le temps qui entraîne l’homme vers la mort à différents visages : la guerre, les camps de concentration, la vieillesse, l’oubli. Et dans ce jeu affreux et absurde de la mort avec la vie, le temps flagelle sans cesse la conscience, car il est devenu mémoire qui pèse lourdement. Cette mémoire ténébreuse des horreurs commises par l’homme se dresse contre l’oubli, car oublier c’est le triomphe de la mort.
Une vision pessimiste de la vie se fait sentir dans la reprise d’un vers qui sert aussi à la construction du poème :
Il ne sert à rien de graver des cœurs sur les arbres. La mémoire se creuse d’elle-même sous les fleurs du deuil.
Il ne sert à rien de trembler ; très peu apprennent à vieillir au présent…
Il ne sert à rien de rire : les arbres s’emparent des joueurs et les étouffent dans la nuit, après avoir entassé leurs souvenirs dans de grands tiroirs invisibles.
Il ne sert à rien de fermer les yeux pour tomber en songe.
Oublier c’est disparaître.
Il ne sert à rien de briser les miroirs : les doubles depuis toujours paressent dans la chambre des agonisants, entre la fenêtre et le gouffre…
Il ne sert à rien de crier au désastre. Les flacons, comme la boîte de Pandore, n’exhalent plus que poussières et vents.
Il ne sert à rien de cueillir des brassées de fleurs;
elles sont les yeux du monde
qui se fanent aux moindres bruissements…
portant l’illusion de la vie
qui se referme à la moindre blessure.
Qu’est-ce qu’on pourrait opposer à la conscience de la mort qui empêche de se réjouir de la vie ? L’amour, la crainte, la joie, le songe, le cri, le combat, la beauté s’avèrent des illusions, car la vie/la mort sont inséparables, les deux côtes de l’existence, de l’être, comme le jour/la nuit qui n’existent que l’un par l’autre. Quoi que l’on fasse, l’homme n’échappe pas à son destin cruel, son grand voyage à travers la lumière aboutit au néant. La cruauté de l’image fait frissonner :
Un aigle viendra, le dernier jour, ramasser les corps pour les déposer sur un autel, dans les branchages, mais les oiseaux les disperseront à coups de bec, et plus personne, jamais, ne se souviendra de la traversée.
Le refus même du miroir, le désir d’ignorer la vérité, d’endormir la conscience et les démons du passé ne sont pas possibles, car ni la vie, ni la beauté ne peuvent guérir les plaies de l’éphémère.
L’image poétique révèle sans cesse les deux côtés de l’existence: visible/invisible, réel/irréel, conscient/subconscient. Les éléments du paysage jouent un rôle double : repères temporels et déclencheurs des souvenirs, car l’existence est stockée non seulement dans la mémoire, mais aussi dans le paysage:
La fuite des ombres dans le vertige dilapide des fragments d’existence demeurés derrière les arbres, au moment où l’enfant qui criait : « Un, deux, trois…soleil ! » se retourne et, comme au sortir d’un cauchemar, fait subitement face au vide. Seule une porte à peine esquissée permet d’accéder au cercle supérieur.
Le paysage immuable semble le seul à opposer à l’éphémère humain, une voie à retrouver pour le retour éternel aux origines, à l’innocence du monde. L’enfant joue aussi ce rôle de rappel, car l’enfance est associée à l’état primordial, au miraculeux. Le poète l’oppose à la tricherie de l’adulte, à sa violence et à son mensonge, au quotidien et à sa laideur auquel il ne peut pas s’échapper.
Et cependant, une seule voix fait face à la mort, celle du poète qui se dresse contre l’oubli et métamorphose le mot en mémoire vivante :
Ce n’est que la mémoire des mots
qui répond au silence.
La métamorphose a lieu ailleurs
dans le face à face intime avec
la mort.
Quelques échos baudelairiens et rimbaldiens se font sentir dans les images à valeur de symbole (le voyage, l’océan, le gouffre, le navire, la mer) dans le dialogue incessant du poète avec soi-même. Chez Colette Klein, il ne s’agit pas d’un voyage exotique, mais à travers le labyrinthe de la mémoire d’où jaillissent les fantômes du passé et les réflexions.
Le thème de la parole, qui refait le monde éphémère, le retient dans la texture du poème contre l’oubli et le néant, se fait jour dans les vers du poète. Le mot comme défi lancé à la mort, le livre comme mémoire des mots, à affronter la solitude et le désespoir de l’être voué à sa fin inexorable :
Il ne sert à rien de nier la parole des anges,
La nuit se charge de brûler le manuscrit de l’ombre,
mais ne peut rogner leurs ailes
déployées sur fond de mémoire
comme pivoines
au jardin.
Cependant, après avoir affirmé un instant le pouvoir magique du mot créateur, l’incertitude se glisse dans la conscience du poète qui s’interroge sans cesse et y réfléchit :
Que restera-t-il du silence ?
Qui croirait encore au miracle de la parole ?
Les mots ne suffisent plus à modeler la lumière.
Parfois la réflexion prend la forme de l’aphorisme :
Toute la vie est un brouillon d’un rêve resté inachevé.
Le poète est conscient qu’on ne pourrait jamais entasser dans les livres tant de vies et de morts, il existera toujours des livres non écrits, car les mots eux-mêmes se refusent parfois à la vie, mais l’écriture reste pourtant la seule à garder la mémoire des rêves et des existences en palimpseste, englouties par la mort.
Ce douloureux il ne sert à rien … de la conscience, qui jalonne la construction du poème et lui assure la cohérence et l’unité thématique, trace le parcours existentiel de l’être, avec ses interrogations et réflexions sur le sens de la vie et de l’écriture.
La série de Il ne sert à rien … qui introduit la réflexion continue :
Il ne sert à rien d’ameuter les vivants…
Il ne sert à rien d’écrire…
Il ne sert à rien de mimer la vie…
Il ne sert à rien de s’enfuir…
Il ne sert à rien de marcher …
Il ne sert à rien de fermer les yeux…
Et après de tentatives vaines d’apaiser la brûlure de la mémoire tuméfiée, le poète conclut en réfléchissant au sens de la poésie :
Il ne sert à rien de mourir
Si ce n’est
pour tisser
dans le grand livre des cimetières
le nom de fantômes qui seront oubliés.
Dans Lettres à Narcisse, la même voix poétique sous l’obsession poignante de la mort se confesse à l’autre, son double, à travers le mythe de Narcisse. Tel Narcisse qui contemple son image dans le miroir de l’eau, le poète se contemple dans le miroir de l’autre, son double, l’ange protecteur, qui finit par prendre son visage.
Le combat entre la lumière et l’ombre, la vie et la mort touche de près le lecteur. La voix de la solitude, du désespoir, de la mémoire blessée empêche de vivre, éveille les fantômes des morts, à la quête d’une délivrance impossible à retrouver, car la lucidité de la conscience suffoque le souvenir de l’ange, la lumière enfoncée au tréfonds de l’être. Le poète rappelle aussi le mythe d’Orphée, descendu à l’enfer pour ressusciter Eurydice. Mais renaître est plus difficile que mourir.
Même si la voix poétique nie son pouvoir de faire ressusciter les morts, le poète se confond avec Orphée et Eurydice à avec sa création, la seule à s’opposer au néant. On dirait que Colette Klein emprunte la voix du philosophe Émil Cioran pour réfléchir à la mémoire et au néant de l’être.
Extraits
Il ne sert à rien de briser les miroirs : les doubles depuis toujours paressent dans la chambre des agonisants, entre la fenêtre et le gouffre, acculés ou cloués, mannequins d’étoffe noire qui grimacent sans que la nuit puisse les porter au-delà de l’aurore.
Mais abandonner tout désir, dans l’attente du vivre, ne résout pas l’énigme.
Une feuille de lierre posée sur leur front les désigne pour victimes.
Ils disent que la vie est ailleurs et même, ils l’écrivent, sur de petits papiers blancs qu’ils accrochent aux arbres. Mais les cimetières bruissent de mots inaudibles qui s’effacent, mesure après mesure, sous la lampe des morts.
*
Même les roches disparaîtront,
comme les arbres et les hommes, les livres,
le goût des fruits dans la bouche de l’automne,
la terre et le soleil …
Tout disparaîtra :
la rosace des jardins où court l’araignée entre les pépites déposées par la rosée,
toute buée,
tout fragment de lumière engrangé à l’équinoxe pour le repos de ceux qu’on enterre en hiver,
les lignes de fuite où se perchent les oiseaux de passage pour écrire une symphonie à perte d’horizon,
la nuit souveraine qui change le feu en nuages, improbable nuit qui dérive avec les mots, à la recherche d’une musique,
ces choses que la mort désorganise dans un rituel d’après-guerre …
Tout disparaîtra,
y compris la fougère et le chêne qui rivalisent dans la moiteur des songes
toute vie qui participe au délabrement
et le sens même de cette vie,
Tout
disparaîtra.